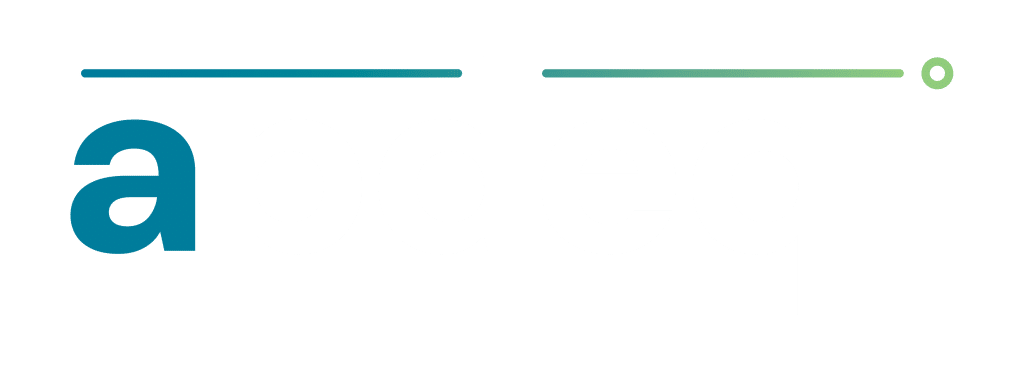Pourquoi la relocalisation industrielle au Québec s’impose aujourd’hui ? Depuis plus de dix ans, je m’intéresse de près aux dynamiques de l’économie québécoise. Mon constat est clair : le Québec est confronté à des défis récurrents — une forte dépendance aux importations, un sous-investissement industriel et une grande sensibilité aux variations du commerce mondial. En relisant une étude publiée en 2017 par Deloitte et E&B Data, motivée entre autres par la chute marquée du dollar canadien, j’ai été frappée par ce qu’elle révélait : près de 9 milliards de dollars de biens manufacturés importés auraient pu être fabriqués ici même. L’objectif? Rapatrier une partie de la production pour stimuler l’emploi local, renforcer l’économie et atténuer les risques liés à l’instabilité des échanges internationaux.
Trois ans plus tard, la crise sanitaire de la COVID-19 a mis en lumière, de façon brutale, la vulnérabilité de notre système. La dépendance à l’égard des importations est devenue indéniable, particulièrement dans des secteurs névralgiques comme la santé, les technologies et l’agroalimentaire. Qui pourrait oublier la pénurie de masques et de respirateurs? Ce fut un signal d’alarme sur notre incapacité à répondre localement à des besoins essentiels en période critique. Dès lors, le discours public a évolué : la relocalisation industrielle n’était plus un simple choix économique, mais bien un impératif stratégique.
Aujourd’hui, de nouvelles turbulences apparaissent avec la hausse des tarifs douaniers américains sur plusieurs produits majeurs. Cette pression accentue les fragilités du tissu industriel québécois et pousse les entreprises à réévaluer leurs stratégies d’approvisionnement et leur compétitivité à l’échelle mondiale. Pourtant, les pistes d’action sont connues – elles tardent simplement à se concrétiser.
Relocalisation industrielle au Québec : un virage collectif à concrétiser
Pourquoi ce retard? Plusieurs freins ralentissent cette transformation essentielle. Le manque d’investissements, publics comme privés, limite l’adoption des technologies avancées et le renouvellement des infrastructures. Malgré les mesures de soutien existantes, les entreprises hésitent à moderniser leurs procédés, freinées par les coûts et les incertitudes. De plus, la complexité des cadres réglementaires et les lourdeurs administratives compliquent chaque démarche. Et que dire de la pénurie de main-d’œuvre, qui pèse lourdement sur la capacité d’agir? À cela s’ajoute la compétition mondiale, avec des pays qui misent sur des salaires très bas et des économies d’échelle difficilement égalables sans un appui structurant et pérenne de l’État.
Cela étant dit, le statu quo n’est plus tenable. En tant qu’entrepreneure, les trois grandes crises que j’ai traversées m’ont convaincue d’une chose : notre modèle économique doit évoluer. Les perturbations se succèdent, les cycles changent, les marchés se redessinent. Mais à chaque soubresaut, la même conclusion s’impose : le Québec doit impérativement accroître sa souveraineté industrielle s’il veut assurer sa résilience et sa prospérité. Ce virage s’impose aujourd’hui comme un incontournable.
Et les municipalités, dans cette équation, ont aussi un rôle moteur à jouer. Elles peuvent contribuer activement à ce changement en créant un terreau fertile pour l’innovation économique. Comment? En prenant le pouls des besoins concrets des entreprises, en identifiant de nouvelles sources d’approvisionnement, en encourageant le regroupement de fournisseurs, en développant des synergies industrielles et des modèles d’économie circulaire, ou encore en formant des alliances logistiques à portée stratégique.
Et si cette période de bouleversements devenait l’occasion parfaite pour révéler les forces dormantes de nos territoires?
🎤 Geneviève Poulin prendra la parole au Forum printanier pour explorer les nouvelles formes de leadership nécessaires à une prospérité durable.